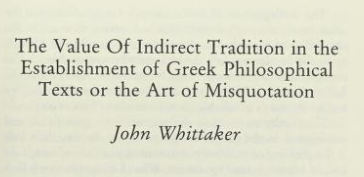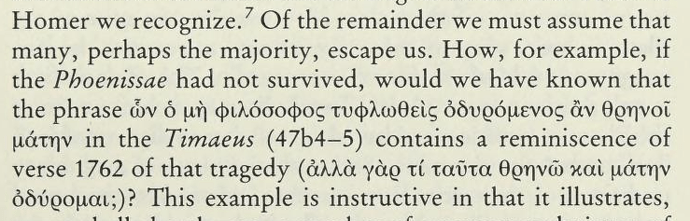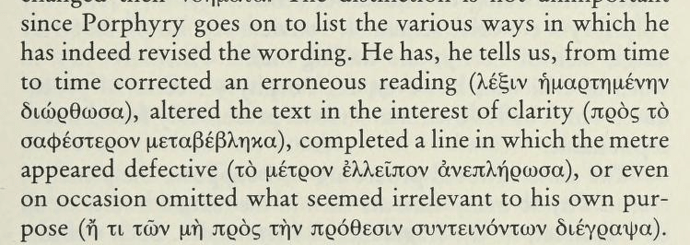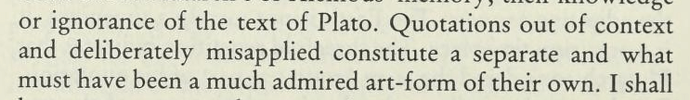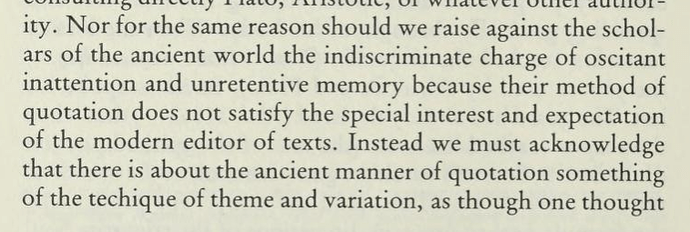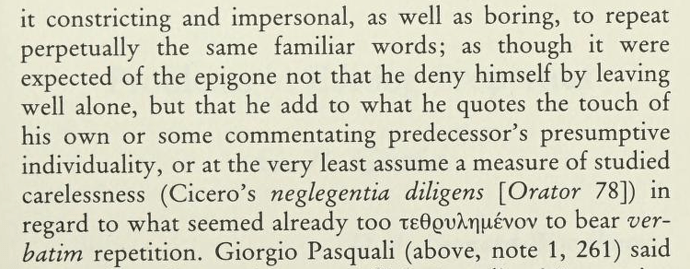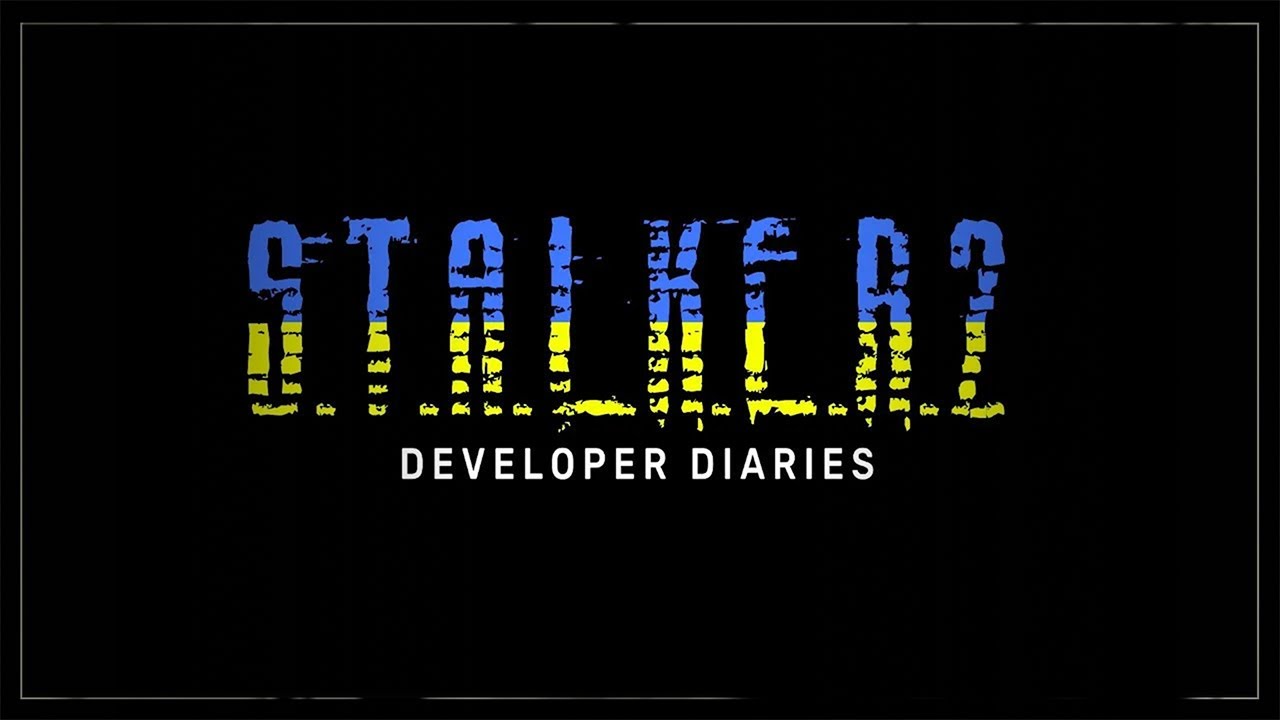Ouh la, où mettre ça. Déjà c’est un petit miracle que je n’ai pas perdu cet onglet, ouvert depuis désormais plus de 10 mois (!). Et je comprends qu’il soit resté aussi longtemps dans un coin, c’est quand même la version numérisée d’un acte de colloque de 1987 sur la question des sources dans la littérature latine et grecque. Dans mon monde idéal, je lirais les trucs comme Neo apprend le kungfu dans Matrix : un téléchargement de 30 secondes, et hop. Bon, dans la vraie vie, ça traîne pendant près d’un an sans que je trouve le courage de me lancer. Si vous voulez vous aussi enrichir votre liste d’onglets d’un lien que vous ne lirez probablement jamais, c’est là :
En tout cas, je sais comment j’ai appris l’existence de ce bouquin : il était dans la biblio des Origines tragiques de l’érudition. Une histoire de la note en bas de page, qu’il me semble avoir sommairement résumé sur feu Boulette de kefta strasbourgeoise. Je vous refait le TLDR version turbo accélérée : longtemps, le boulot de l’historien était de raconter les batailles façon peplum, on voulait du sang de l’héroïsme du romanisme ; et pouf un jour y a des historiens allemands, et notamment Leopold von Ranke, qui découvrent à la suite de la révolution française que vu que le roi est mort et qu’en plus on peut désormais accéder tranquillou aux archives nationales, eh bien on va faire un truc vachement drôle, c’est raconter l’histoire en se basant sur des sources, et on va même s’en vanter. Sauf qu’en fait en scred ça faisait déjà un siècle et demi que la note de bas de page était déjà utilisée, avec un rôle assez particulier et quasi exclusif de subtweet visant les autres auteurs du moment.
Bref.
Je vois exactement ce que je voulais y lire, page 63 très exactement :
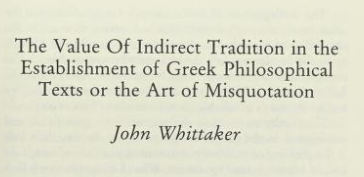
Il est généralement admis que lorsque de petits fragments de texte sont transmis indrectement sous forme de citations, ils sont vus comme peu fiable étant donné qu’ils ont probablement été cités de mémore, ou empruntés à quelqu’un d’autre qui les citait de mémoire, ou encore pire, cités de mémoire à quelqu’un d’autre qui les citait de mémoire. La raison à cela, nous dit-on, est que ‹ c’est la pratique des plus anciens écrivains… de citer de courts passages comme ils s’en souviennent au lieu de chercher de manière laborieuse sans aide de chapitres numérotés ou de vers. › " Or, conteste John Wittaker, dans la tradition, on ne s’amusait pas à citer de mémoire sans vergogne, ni à retranscrire de longs textes avec forcément beaucoup de respect : il existe au contraire une longue tradition de déformations volontaires de citations, argue-t-il.
Il prend pour exemple un traité philosophique platonicien qui n’évoquera rien à personne ici (pas même à moi, alors que j’ai fait ma maîtrise sur Platon, c’est vous dire) : le Didaskalikos, d’Alcinoos. Son principal intérêt ici est d’être un patchwork de collages d’œuvres de Platon déjà vieilles de 3-4 siècles, lesquelles oeuvres sont déjà truffées de références voilées dont on connaît certaines (les références à Homère) et d’autres pas du tout, parce que les textes ont été perdus, les refs avec.
(excellente question, très actuelle, qui nous renvoie au néoplatonicien Tic & Tac : Rangers du risque : comment savoir que tu rates une ref si t’as pas la ref ?)
Mais, remarque, Whittaker, le texte s’adresse justement par définition à des gens qui connaissent fort bien le texte original, à tel point qu’il n’est ni besoin de le préciser ni besoin de lui être fidèle à l’identique. Il est même permis de l’améliorer, si on estime qu’une rime d’origine déconne un peu, que la démonstration est pas ouf-ouf de clarté, ou juste qu’osef de certains détails, comme le fait Porphyre de Tyr (on avait vraiment des blazes de ouf, à l’époque).
Or dans le Didaskalikos, Askiloos passe son temps à… inverser l’autre des mots. Genre It’s alone to go dangerous, take this. Comme ça, tout le temps. (enfin, pas tout à fait comme ça, le grec ancien étant une langue à déclinaison, l’ordre des mots compte moins qu’en français dans le sens). Effet de style de type hyperbate ? Mystère. Il fait même ça avec des paras, qu’il déplace entre eux, manifestement pas content de l’ordre dans lequel Platon déroule ses idées, ce qui est un peu gonflé, quand même, vire des mots qui lui plaisent pas, ou en ajoute, ce qui oriente parfois le texte vers un côté plus mystique qu’il n’avait pas à l’origine (et à chaque fois qu’on vous bassine avec le mythe de la caverne, qui est un peu l’Evo Moment #37 de la philo, n’oubliez jamais que ce sont les néoplatoniciens, mystiques, qui ont donné son importance à ce qui n’occupe en vrai qu’une page dans toute l’œuvre de Platon et n’a probablement jamais eu pour lui l’importance qu’on lui a donné par la suite, notamment en la recopiant elle et seulement elle, en boucle, selon un procédé très classe du temps où faute d’imprimerie, on aimait bien faciliter le boulot aux copistes et résumer les bouquins par une page censément symbolique, mais je m’éloigne).
Bref, Whittaker insiste sur une thèse : non les écrivains étaient pas des étourdis, c’est juste que selon lui, et j’adore cette thèse qui fait passer les trolls russe pour de vulgaires copistes sans imagination :
Et de citer des extraits étonnants, où, alors qu’il prétend citer Platon, Alcinoos mélange Platon et Aristote dans la même phrase.
Qu’en conclure ? Deux choses : que les néoplatoniciens voyaient dans l’art de citation quelque chose d’assez libre pour laisser la place à la réinterprétation personnelle du texte d’origine, que ce soit pour des raisons cosmétiques ou philosophiques, et qu’il n’existait pas de caractère sacré dans le verbatim d’un auteur - dont, du reste, il est bien difficile de savoir s’il n’avait pas déjà été déformé une année, une décennie ou un siècle plus tôt. Bref : qu’en des temps antiques de la philo, yolo.
Le second point, galipette un peu facile, est que la tendance à interpréter les citations antiques comme des fautes de mémoire d’auteurs étourdis ou peu consciencieux nous renseigne moins sur leur rapport à l’écrit à eux qu’à nous,
Où l’on perçoit que le point d’entrée dans cet article, le procès en manque de rigueur, nous renvoie aux exigences de fidélité et d’exactitude qui sont ceux de la littérature occidentale moderne depuis pas si longtemps que ça - à peine deux-trois siècles, cf Les origines tragiques de l’érudition, la boucle est bouclée, je vais enfin pouvoir fermer cet onglet en paix, adieu, non sans me demander à quoi aurait ressemblé l’histoire de l’humanité si celle-ci avait eu accès plus tôt à Lightshot pour Chrome.