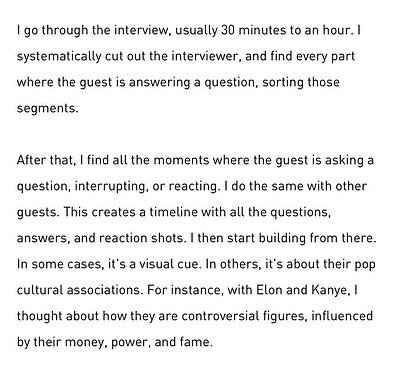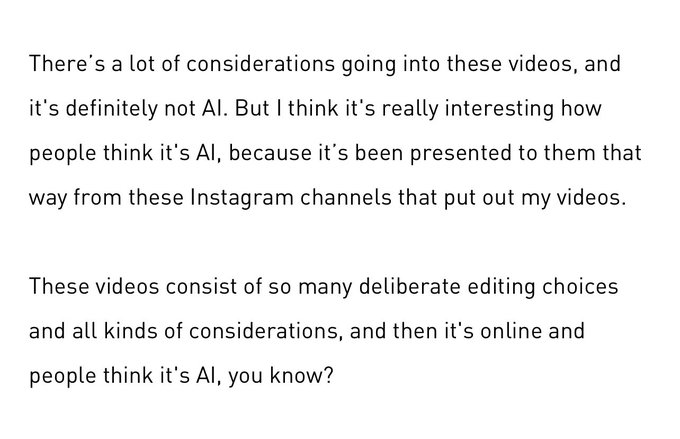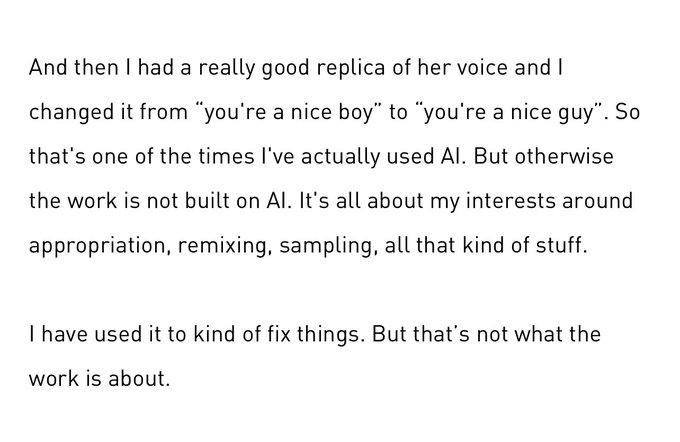Furiosa – A Mad Max Saga
★★★★ En bon adepte du journalisme total, je suis allé voir Furiosa mais ❶ en IMAX et ❷ en Australie. Rep’ à ça, Hideo ! On ne peut pas dire que le public australien soit particulièrement patriotique (en tout cas en semaine) car la salle était aux trois quarts vides, comme partout ailleurs. À chaud, j’ai bien aimé (comme souvent). À froid, je suis généralement plus difficile, mais j’en garde toujours un excellent souvenir.
C’est un film très comparable, dans ses ambitions, ses défis et son résultat au Box Office (gloups) à Solo – A Star Wars Story. Même le titre est similaire !
Dommage, car Furiosa réussit grosso modo là où Solo avait échoué : il étale mieux les origines sur une quinzaine d’années qui permettent de comprendre et surtout de croire comment le perso en est arrivé là dans Fury Road (le Mad Max précédent qui introduisait le personnage de Furiosa), tout en rajoutant des trucs intéressants au lore de la franchise, et avec un écart de talent moins évident entre les deux actrices – même si ATJ n’a clairement pas le charisme de Charlize.
Comme Fury Road, Furiosa a des petits problèmes de structure, et la dernière séquence ne vaut bizarrement pas les morceaux de bravoure qui la précèdent ; j’aurais même tendance à dire que le climax du film arrive bien trop tôt. Comme Fury Road, ça donne quand même trois séquences d’action et de voltige époustouflantes, a fortiori en IMAX. J’avais dormi une heure dans l’avion et peur de m’effondrer pendant la séance → que nenni.
C’est 20% moins bien que Fury Road, mais n’est-ce pas suffisant pour apprécier d’avoir plus de Fury Road dans nos vies ? Bien sûr que si !
Sinon, sponsorisé par Airbus :
All of Us Strangers
★★⭐︎⭐︎ Oh la la, c’est déprimasse les patatas. @iggy , tu m’avais donné envie de le voir. Je t’avoue que je ne me suis pas vraiment senti concerné par le film et les différentes angoisses de son protagoniste, mais je comprends que je ne suis pas le public, à bien des points de vue, et donc je n’en veux pas au film.
Je suis surtout soulagé (je prends un risque, il reste cinq minutes) que le film ne finisse pas sur un twist à la con du genre le BF était un fantasme tout du long, comme je le craignais à la moitié du film… (cinq minutes plus tard) Oh… Mais sinon, excellent casting, et j’apprécie que le film soit d’ailleurs si ramassé à tous points de vue (casting, lieux, temps, métrage).
Détail qui m’a consumé tout le restant du film : un pré-ado de 1987 aurait vraiment Welcome to the Pleasuredome dans sa collection de disques ? Le mec a raté sa carrière de Disc Jockey sur Radio 4.
The Iron Claw
★★★⭐︎ Autre film pas joie-joie dans l’absolu mais bien plus pittoresque et parfois même cocasse de par l’univers concerné, cette fresque « inspirée d’une histoire vraie » sur une famille de catcheurs professionnels américains texans au début des années 80, célèbres chez les aficionados de catch autant pour le talent de la troupe (un père et quatre frangins) que pour les déboires invraisemblables qui ont frappé la famille sur le chemin de la gloire.
Je connaissais, dans les grandes lignes, le fil rouge des mésaventures de la réelle famille Von Erich qui a motivé A24 à en financer un film. On ne peut pas dire que le catch soit le divertissement athlétique le plus subtil qui soit, et le film est au diapason avec ❶ une bande-son qui n’évite aucun gros tube rock de la période 1979〜1988 ❷ un scénario qui adresse toutes les transformations de la société US de l’époque et ❸ une équipe des costumes et des postiches qui s’en donne à cœur-joie. Faut donc se lancer dans le film en acceptant le sujet et ses gros sabots.
Mais à l’instar de la boxe, le monde du catch (a fortiori à son époque « régionale » précédant l’hégémonie de la WWE) est un univers qui se prête particulièrement bien au grand écran, grâce à la grande précarité de son milieu, l’équilibre bizarre entre camaraderie et compétition de ses acteurs, son ancrage dans l’Amérique rurale ouvrière de droite qui s’est foutue en l’air avec Reagan, et la toxicité masculine implicite du milieu. On touche à un truc vrai sur l’Amérique avec ces matches chiqués.
Il y a quelques mois, je me suis retrouvé (sans trop savoir pourquoi) invité au mariage d’une connaissance professionnelle californienne, et j’ai ainsi découvert qu’à l’exception d’un frangin rebelle, les deux familles étaient clairement Republican, mais dans tout le spectre du camp politique concerné : des familles riches venues des Blue States, des agriculteurs qui ne voulaient pas qu’on leur prenne leurs fusils, ou le vétéran probablement Trumpiste encore fâché contre la France d’avoir refusé l’invasion du Chirak sous Lirac (ou l’inverse). Eh bien, j’ai retrouvé beaucoup des personnages de ce mariage dans ce film.
Gigi
★★★⭐︎ Pour me rincer le cerveau de cette succession de films mâles-eureux avant l’atterrissage, quoi de mieux que Gigi ? Qui n’aime pas Gigi ?
Grand classique de Vincente Minelli (1958), neuf Oscars, et kinda la suite commerciale directe de My Fair Lady (une grosse partie de la même équipe derrière, quasiment le même pitch) mais transportée de Londres à Paris. C’est à dire, au lieu que tout le monde dans le film soit pincé du cul, tout le monde dans le film est obsédé par le cul.
C’est une histoire d’amitié tendancieuse entre Gaston, un queutard blasé trentenaire qui ne sait plus comment gaspiller la fortune dont il a hérité, et Gigi, une adolescente qui se fait éduquer par sa grande tante courtisane à devenir une parfaite petite pute pour la haute société parisienne des années 1900… Euh, mais non, revenez, je vous jure, c’est pas ce que vous pensez ! (C’est tout ce que vous pensez.)
Il y a vingt-cinq ans, Gigi était une comédie musicale charmante mais quand même un peu chelou ; rien que la fameuse introduction crypto-pédophile Thank heaven for little girls de Maurice Chevalier me faisait déjà lever un sourcil jusqu’au plafond. Confronté aux sensibilités du XXIème siècle, le film devient com-plè-tement ma-boule. Je n’ose imaginer si la jeunesse américaine retombait dessus aujourd’hui. Ouyayaye, que dirait-elle ? Neuf Oscars !
Je n’y avais jamais pensé auparavant mais je soupçonne que La France, et son image dans la culture populaire mondiale, et l’accent français stéréotypé d’Hollywood, doivent beaucoup à ce film en particulier, surtout qu’il arrive quasiment en même temps que Saint-Tropez et Bardot. Alors qu’en vrai, je m’insurge : la France du XXème Siècle n’était pas du tout un pays #MeToo, on le saurait !
Pépé le Putois est une parodie des rôles de Maurice Chevalier à Hollywood, mais la ressemblance n’est jamais aussi frappante que dans ce film (malgré l’âge de l’acteur à l’époque). Je ne sais pas si le roman original signé Colette a un penchant plus féministe et libéral que le film (écrit par des mecs) ; je le soupçonne car on sent que les personnages féminins ont un petit quelques chose en plus, par rapport à beaucoup de rôles féminins de cette époque d’Hollywood, mais trop peu exploité dans le film.
Ce que je continue de trouver génial dans Gigi, et assez fidèle au souvenir des quelques bouquins de Colette que j’ai lus au collège, c’est le côté picaresque de ses personnages, qui refusent de se plier à la bienséance de l’époque. Globalement, tous les personnages du film sont odieux et néanmoins sympathiques. Dans leur monde, le pire crime qu’on puisse commettre, c’est de manquer de panache, ou de ne pas être intéressant. Du coup, comme tous les personnages sont pétris de défauts, ils débordent aussi de personnalité, qu’on devine parfois en deux lignes de dialogue.
Ça ne fonctionnerait pas sans le charme des interprètes. J’adore l’acteur Louis Jourdan (Gaston), en premier lieu parce que c’est l’un des meilleurs méchants de Columbo. Il est parfait ici en type concrètement infecte et problématique mais avec qui on aimerait volontiers prendre un verre ou trente. Maurice Chevalier est hilarant en Obi-Wan de la quéquette, et Leslie Caron réussit globalement le difficile jonglage de faire croire à une Gigi innocente mais pas naïve, jeune mais pas puérile, et à manipuler l’âge ambigu du personnage dont on pige jamais trop si elle a treize ou dix-sept ans (comme si cela atténuait le problematicus). On sent que tous les acteurs ont un CV de théâtre ou de Music Hall : sans sombrer dans les chorégraphies d’arts martiaux de Singin’ in the Rain, les acteurs et actrices s’accaparent l’espace du studio de façon épatante – et je dis « studio » mais plein de scènes ont été filmées sur de vrais sites parisiens aujourd’hui disparus, ou complètement transformés comme chez Maxim’s (bonus tourisme).
Mon seul véritable problème avec cette comédie musicale – enfin… à part le… Tous les… Vous voyez, quoi – c’est que je ne suis pas fan des chansons. Elles sont pas mal, et certaines sont intéressantes dans leur structure ou leur concept, mais les morceaux sont globalement beaucoup moins catchy que ceux de My Fair Lady. Ça m’a frappé pendant ce visionnage mais le Beauty & the Beast de Disney s’est énormement inspiré de Gigi : pas seulement le (Maurice) chandelier, mais même la structure et l’instrumentalisation de certains morceaux (sans doute pour faire « français comme Gigi »). Eh bah, je préfère les ersatz de Disney.