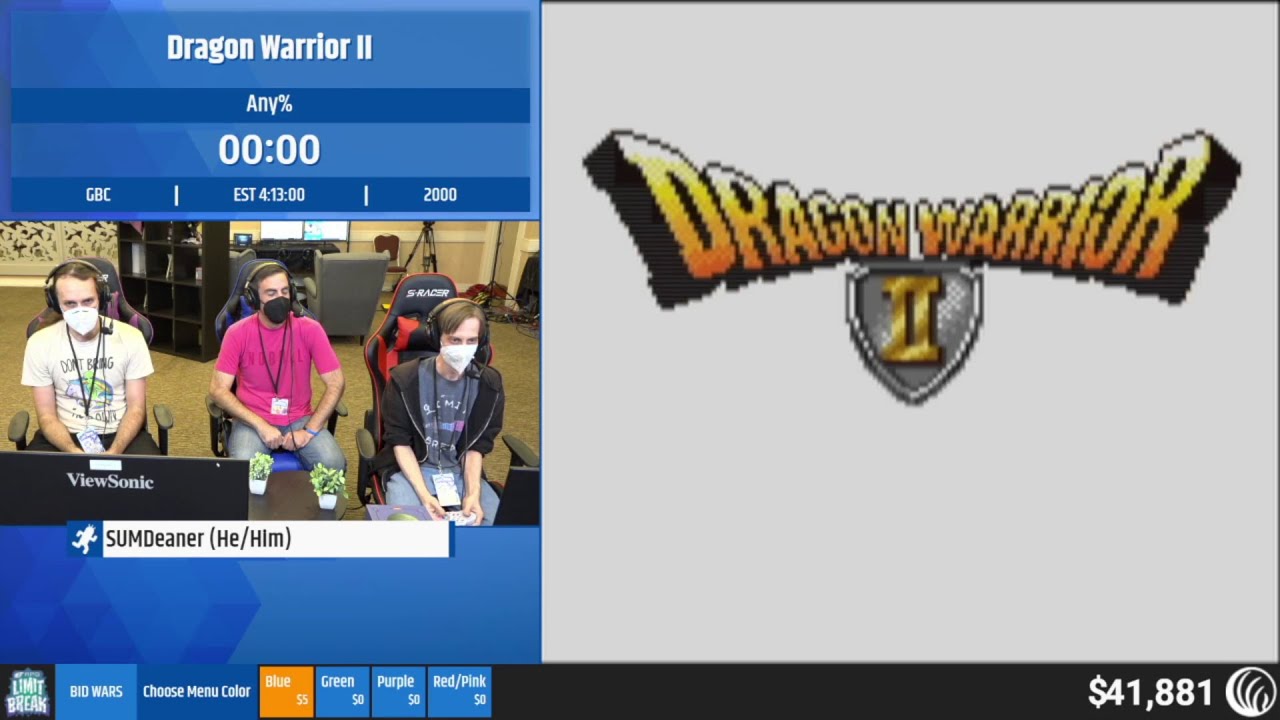J’ai l’impression d’être le seul type qui n’a pas passé son automne sur Silksong. A la place, je me suis lancé dans une petite pérégrination interstellaire.
Star Wars Outllaws, c’était ma caution détente après avoir pas loin de fini Hollow Knight premier du nom (mais Honet des glaces a eu raison de ma patience). Je suis à peu près convaincu de ne pas du tout avoir joué au même jeu que la plupart de mes congénères, puisque pendant les cinq premières heures, je me suis extasié sur le fait que le jeu de Massive Studios était le Beyond Good & Evil 2 qu’Ancel a teasé pendant des décennies. Le côté Blade Runner de villes futuristes étroites et interlopes, l’héroïne pleine de bonne volonté qui tente de trouver sa place dans un monde corrompu, ses partenaires d’aventure qui font dialogue et entraide, jusqu’à faire ressentir leur absence à même la manette quand leur kidnapping entraîne la disparition de fonctionnalités bien utiles… Tout ça, c’est du pur BGE. Mais surtout, il y a ces changements d’échelle grisants, ce sentiment d’être à un moment recroquevillé incognito dans le tuyau d’aération d’une base de l’Empire, à marcher à tâtons, le suivant en plein dogfight au milieu des ceintures d’astéroïdes de Kijimi ou Toshira, à avaler les années-lumière à bord de son coucou de l’espace.
Je me suis même plusieurs fois dit que Star Wars Outlaws, était, dans sa philosophie, sur ses cinq premières heures, un excellent jeu des années 2000, qui assume de s’appuyer sur des conventions prévisibles - grappin, plateformes aux rebords colorés à la Unch, caméras de surveillance, etc. - pour proposer une aventure rythmée, ici infiltration, là gunfight, là encore jeu de cartes dans une salle clandestine poisseuse, ou course de speeder dans les steppes.
Et puis, est arrivé ce qui est arrivé : le jeu a commencé à se piquer de ressembler à un monde ouvert. Un monde ouvert peu enthousiasmant, car il n’en a pas le scope - les planètes que j’ai parcourues se réduisent essentiellement à une ville, une étendue un peu déserte et quelques bases disséminées ici ou là, façon Far Cry du pauvre ; les déplacements en speeder sont d’une terrible tristesse - la machine semble flotter à 50 cm du sol sans n’avoir jamais aucune interaction avec l’environnement, comme si ce dernier n’était qu’une feuille plane sans vie ; les histoires de cartels en concurrence, qui dessinent un monde de Star Wars particulièrement noir et cynique, ou tout n’est alliance d’appoint et trahison en puissance, finissent par diluer le fil narratif et l’implication du joueur, faute d’enjeux auxquels s’identifier. Surtout, et c’est ce qui m’a achevé après une quinzaine d’heures de jeu, si les planètes témoignent d’un amour évident de la licence, leurs décors respectifs sont en termes de jeu parfaitement interchangeables, et les missions sur Kijimi, la planète enneigée, ne demandent rien qui ne soit demandé sur Tatooine : ce sont les mêmes gardes un peu tête en l’air, les mêmes serrures à pirater, les mêmes caméras à désactiver, les mêmes fichus conduits d’aération (mais combien y en a-t-il de kilomètres au juste dans la bordure extérieure ??), et au final, la même impression de toujours s’infiltrer de la même manière dans les bases qui se succèdent. On cherchera, en vain, des traces de pas dans la neige à effacer, des planques à l’ombre des deux soleils de Tatooine, ou autres petites variations ludiques. Pour un jeu d’infiltration, c’est quand même un peu triste de se montrer plus pauvre qu’un bon vieux Splinter Cell sorti deux décennies plus tôt, et qui n’allait pourtant pas hyper loin. Bref, Star Wars Outlaws a le défaut classique d’un open world, c’est un jeu beaucoup trop procédural pour parvenir à renouveler l’intérêt du joueur. Et les quelques séquences à grand spectacle, genre escalade d’un navire spatial échoué, sonnent je trouve assez faux - d’une manière générale, j’ai toujours du mal à admettre que la même héroïne qui est incapable de monter sur un caillou lors des phases d’infiltration soit capable de jouer à Tarzan à huit cent mètres au-dessus du vide vingt minutes plus tard.
Bref, j’ai beaucoup aimé le début, et je ne m’interdis pas d’y retourner un soir d’ennui, mais c’est quand même dommage d’avoir reconstitué avec autant d’amour les bas-fond des planètes de Star Wars pour y déployer des mécaniques de jeu aussi robotiques et circulaires.
Du coup, j’ai décidé de m’envoler pour Tallon IV.
Il m’a fallu 15 heures tout rond pour finir Metroid Prime Remastered à environ 70 %. Autant je me suis pris STO par pure curiosité pour un objet industriel très commenté, autant là, j’étais en pleine bulle temporelle. Metroid Prime est un de mes jeux fétiches, un des titres dont je suis capable de lancer l’intro sur YouTube juste pour le plaisir de retrouver son atmosphère musicale assez incomparable. Par ailleurs, dans mon panthéon personnel, c’est un marqueur assez unique : là où la plupart des jeux qui m’ont construit datent de mon adolescence sur Nintendo 64, Metroid Prime est le premier jeu à m’avoir sidéré sur mon siège alors que j’étais désormais (jeune) adulte et désormais payé pour jouer. Maintenant que j’y pense, à l’heure où je vous écris, c’est même assez littéralement mon mid-life jeu, celui qui sépare de manière presque parfaitement symétrique mes un peu plus de deux premières décennies de mes un peu plus de deux dernières, une sorte d’objet temporel à cheval entre deux chaises mémorielles, jeu pliure entre ma nostalgie et ma vie active. Metroid Prime, c’est à la fois ce même enthousiasme émerveillé face à une nouvelle transition d’une licence plane vers la 3D, et les mêmes sursauts de stupeur admirative face aux premières buées sur la visière de Samus, que quelques années plus tôt les galipettes enivrantes et un premier poirier mémorable sur la cime d’un arbre du jardin de Peach, la même excitation malicieuse à brûler des toiles d’araignées avec une torche d’appoint dans un vieil arbre centenaire. Mais c’est aussi cette période où les forums aidant, un certain @Pierre répétait « jeu émergent » après chaque phrase ; où @tristan me faisait bien involontairement découvrir Bright Eyes, où entre deux dissertations sur Don Rosa, @Merou me faisait bientôt remarquer ma sale manie de ponctuer chaque phrase de deux points d’exclamation (je me suis soigné, depuis). C’était la période GameCube, et le petit monde du commentariat vidéoludique attendait chaque nouveau jeu Capcom comme le Messie, où une console de salon Nintendo recevait à la fois Resident Evil et Metal Gear Solid. Metroid Prime,c’était à la fois le dernier jeu Nintendo 64 et le premier signe d’une décennie marquée par la suprématie commerciale des FPS.
Une demi-vie plus tard, et un remaster absolument impeccable derrière, que m’en reste-t-il ? La même fascination, à l’identique, pour la première heure de l’aventure, un modèle indépassé d’introduction maîtrisée, intense et immersive ; la même admiration pour son élégance narrative, et je me demande si on a fait beaucoup plus précurseur que Metroid Prime en matière de narration environnementale ; le même ravissement enfantin face aux effets de buée, ou aux reflet des yeux de Samus dans sa visière - c’est incroyable que ce procédé, si visionnaire, si efficace en matière d’immersion et d’incarnation, ait finalement été si peu repris (je ne vois que Dead Space à faire usage aussi malin du HUD, mais de manière complètement inversée, au lieu d’intégrer le personnage au HUD, il intègre le HUD au personnage).
Je ne vais pas rappeler la parenté tarte à la crème entre Metroid et Alien : elle n’est intéressante qu’en ce qu’elle est trompeuse. Outre que les Metroid sont de gentilles méduses volantes plus baveuses qu’effrayantes, et fort peu phalliques, le parti pris des deux saga est viscéralement opposé. Dans Alien, comme le stipule son célèbre slogan, dans l’espace, personne ne vous entendra crier : c’est une marche annoncée vers la solitude muette et l’hostilité bestiale d’espaces étrangers infinis. Dans Alien, on est bien peu de chose, un grain de poussière dans la voie lactée, du bétail, de la chair à pâté. Metroid, au contraire, consiste à se raconter sa progressive rencontre avec soi-même : le monde entier, derrière son hostilité d’apparat, est entièrement à sa taille, à sa forme, c’est une ingénieuse et intimidante serrure dont on se découvre l’unique clé. Et derrière ses multiples références, que j’avais ratées autrefois, à Alien IV: Resurection, Metroid Prime n’est jamais aussi prenant que lorsque ses logs racontent la fascination des pirates de l’espace pour Samus : c’est d’elles dont ils ont peur, contre elle qu’ils se préparent, enfin elle et ses armes qu’ils essaient d’imiter. Plus l’aventure progresse, plus il n’est question que de ça, de l’impossible montée en puissance de pirates de l’espace, qui s’équipent tantôt du rayon de glace, de plasma, ou à ondes, dans une tentative vouée à l’échec d’opposer au joueur ses propres armes. Même les métroïdes eux-mêmes, dans un twist que j’avais complètement oublié, deviennent, au prix d’expérimentations génétiques bien commodes, des cibles qui imitent à leur tour chacune de nos armes, étonnant pinacle d’un titre qui finit par faire de son héroïne l’unique monstre, au sens le plus littéral, celle que l’on craint, observe, décortique, tente d’amadouer.
Ce renversement du schéma d’Alien, il échappe fatalement au premier regard, d’autant que Samus n’a rien de monstrueux, ni même grand chose de charnel : elle n’est que métal, un métal souple, dynamique et scintillant, quelque part armure, quelque part belle cylindrée, parfois les deux en même temps, quand elle se transforme en boule, et que la transition ressuscite quelque chose de Saint Seiya et Transformers, une fascination pour les volumes de tôles complexes qui se fondent d’une forme en une autre. Et qui explique, peut-être, que l’absurdité difficilement contestable d’une femme chasseuse de prime de l’espace qui se transforme en bille de flipper donne lieu à un émerveillement purement visuel pour cette belle bille métallique, ce calot si brillant que, je le jure, j’aurais voulu ressortir ma trousse de CE2, l’attraper, et la ranger dedans.
Je crois que je peux en conclure que Metroid Prime me fait à peu près le même effet qu’à l’époque, et que c’est à la fois l’effet d’un remaster qui magnifie ses qualités esthétiques, et la singularité d’une aventure à la fois avant-gardiste, et qui n’a finalement presque jamais été imitée. Je lui trouve, quand même, quelques légères faiblesses qui me choquent davantage aujourd’hui qu’hier, un peu de backtracking gratuit, certainement excusable en 2002, quand les attendus d’un jeu et de sa longueur étaient bien plus homogènes qu’en 2025, mais qui ressemblent aujourd’hui à des facilités fort dispensables. Je me suis également rendu compte que j’avais écarté de ma mémoire que le bestiaire était assez oubliable, tout comme le thème musical fort agaçant de la région polaire (je n’avais gardé en tête que les basses obsédantes des grottes de lave). Au final, quand même, cette simple impression : il est remarquable que ce jeu ait si peu, et si bien vieilli.

Suite du périple : ce sea Star Ocean The Second Story R, après un pic-nic-douille impitoyable.